Le photomontage avec Nelson Mandela est osé, mais il a ses raisons…..les
deux personnages n'ont évidemment pas la même aura internationale, loin de là,
mais lorsqu'on commence à s'intéresser à la vie de ce portoricain de 70 ans qui
patiente depuis 32 ans dans les prisons des USA, on va de surprises en surprises…
On s'aperçoit que c'est un garçonnet de neuf ans qui
laisse derrière lui Porto-Rico pour suivre sa famille aux États-Unis, à 14 ans
il ira vivre avec sa sœur à Chicago, à 18 ans il sera pendant des années,
soldat au Vietnam.
De retour avec sa médaille militaire, il découvre, en 1967, dans l'Illinois la
réalité sociale déplorable de la diaspora portoricaine. Il s'engage très
activement dans un gigantesque travail pour améliorer la qualité de vie de
cette communauté. Il semble être partout à la fois: Un lycée pour les
Portoricains, un centre culturel, un combat pour une éducation bilingue, un
accès à l'université, la fin de la discrimination dans les services publics
(l'apartheid n'a pas été l'apanage de l'Afrique du sud). Il a été l'un des
fondateurs de l'école Rafaël Cancel Miranda, il a été également animateur de la
première communauté du Nord-ouest (NCO) , ASSPA, ASPIRA, et de la première
église congrégationiste de Chicago….Non ce n'est pas fini, attendez, il s'est
battu pour créer FREE: un centre de semi-liberté pour des toxicomanes
condamnés, et un centre éducatif pour les prisonniers latinos de la prison de
Stateville dans l'Illinois.
Cette liste est longue, impressionnant, pour un homme qui en 1967 n'a que 24 ans, elle est largement suffisante pour nous permettre d'apprécier l'invraisemblance d'une implication directe d'Oscar Lopes Rivera dans les attentats meurtriers commis par des indépendantistes portoricains au début des années 70.
Première lettre : "Les mains
contre la vitre"
Ma Chère Karina, il n'a pas été facile de choisir un
titre pour ces lettres que j'ai décidé de t'envoyer régulièrement depuis la
prison.
En t'écrivant à toi dont j'ai définitivement perdu
l'enfance et l'adolescence, je sais que je parle à des milliers de jeunes
portoricains pour qui mon nom ne signifie rien.
Je suis un vieux lutteur de 70 ans, je suis en prison
depuis 32 ans, je ne veux pas revenir sur les raisons politiques qui m'ont
conduit à cet enfermement, d'autres l'ont déjà fait. Je veux seulement clamer
de nouveau que je place le respect de la vie humaine au-dessus de tout, que je
respecte la vie au-dessus de tout, que je n'ai jamais fait de mal à un être
humain et n'en ferai jamais.
On laissait Clarissa rentrer avec un paquet contenant
trois langes et quelques biberons de lait. Pendant les visites, il y a du côté
de la famille comme du côté des détenus, des caméra qui enregistraient tous nos
mouvements, mais ironiquement, aucune n'a jamais pu me laisser une photo de moi
et ma petite fille. Il y avait toujours trois ou quatre gardiens qui
m'escortaient et j'avais les pieds enchaînés. J'étais le seul prisonniers a
être à ce point surveillé aux heures de visites.
Il était difficile de te distraire quand on était dans
le local des visites. Alors, pour aider ta mère qui essayait de passer le plus
de temps possible avec moi et t'occuper un peu, on avait inventé un jeu
spécial. Tu posais tes petites mains de bébé sur le verre et je faisais la
même chose, ainsi nos quatre mains se retrouvaient ensemble et pouvaient "se
toucher". Nos mains sautaient, se poursuivaient comme des araignées
sur les fils invisibles de la tendresse. Il manquait le contact véritable
interdit par la vitre, mais il y avait un langage privilégié entre toi et moi,
entre tes tendres mains de bébé et mes vieilles mains, pâles de réclusion, qui
voulaient s'envoler mais se calmaient, soumises quand tu les caressais.
Nous avons utilisés pendant des années cette
"danse des mains" pour communiquer entre nous. Le temps est passé, tu
as grandi, le contact physique avec les visiteurs m'étant interdit, pendant
toutes les années que j'ai passé à Marion, je n'ai pas pu t'embrasser, toucher
et sentir tes cheveux. C'était pareil pour ta mère qui me quittait en larmes
quand je savais contenir les miennes.
Un jour enfin, on m'a transféré à la prison de
"Terre haute" dans l'Indiana. La- bas, on m'a annoncé que je
pourrai recevoir des visites et avoir des contacts physiques avec mes proches.
Ta mère est arrivée avec toi et ma nièce Wanda, tu avais seulement sept ans.
Elle et ma nièce m'ont alors embrassé, mais toi, tu t'es mise face à moi et tu
as levé tes mains pour les poser sur une vitre imaginaire attendant que je
fasse la même chose. Encore bien jeune, après tant d'années derrière cette
barrière, tu croyais que nous devions continuer notre jeu. Ta mère t'a dit
alors:" Maintenant tu peux toucher ton grand-père", tu t'es jeté dans
mes bras, nous nous touchions pour la première fois….
Cette vitre, malgré tout, reste encore un complice
entre toi et moi. A travers elle, dans ces pages, je continuerai à te
raconter mes souvenirs, mon histoire présente, nièce tant attendue...
Avec énormément d'amour, en résistance et lutte…
Deuxième
lettre : “ Là, où respire la mer"
Ma
chère Karina,
Après
la famille, ce qui me manque le plus c'est la mer. 35
années sont déjà passées depuis la dernière fois que je l'ai vue . Et pourtant
je l'ai très souvent peinte, aussi bien celle de l'Atlantique que celle de la
Caraïbe…cette écume souriante de Cabo Rojo est de la lumière mêlée de sel.
Pour n'importe quel habitant de Porto Rico, vivre loin de la mer est une chose incompréhensible. Et c'est bien différent quand on est en liberté de se mouvoir n'importe où et de voyager à sa rencontre. Peu importe qu'elle soit grise et froide, même si tu rencontres la mer dans un pays lointain, tu te rends compte qu'elle est “toujours recommencée", comme l'écrit un poète (note du traducteur : il s'agit probablement d'une allusion au poème de Paul Valéry: Le cimetière marin), et qu'à travers elle peuvent passer des poissons qui s'approcheront de ta terre et venant de là-bas, t'apporteront des souvenirs
J'ai appris à nager très jeune, je devais avoir trois ans. Un cousin de mon père qui vivait avec nous était pour moi comme un frère aîné, il m'avait emmené à la plage où il avait l'habitude de nager avec ses amis, il me lançait à l'eau pour que j'apprenne. Après cela quand j'étais à l'école, j'avais l'habitude de faire des escapades avec d'autres garçons jusqu'à une rivière proche, tout cela me paraît bien loin.Ici dans la prison, j'ai ressenti bien des fois la nostalgie de la mer. L'envie de la prendre à plein poumons, de la toucher, de m'inonder les lèvres, mais tout de suite je me rends compte qu'il se passera sans doute bien des années avant de pouvoir accéder à ce plaisir bien simple.La mer me surprend toujours, mais je crois que je n'ai jamais eu autant besoin d'elle que le jour où l'on m'a transféré de la prison de Marion, dans l'Illinois, à celle de Florence, dans le Colorado. A Marion, je pouvais sortir dans la cour une fois par semaine, et de là, je voyais les arbres, les oiseaux… j'entendais le bruit du train et le chant des cigales…je courais sur la terre, je la sentais, je pouvais agripper l'herbe et laisser les papillons m'entourer…mais à Florence tout cela s'est terminé.Sais-tu que la ADX, c'est à dire la prison de sécurité maximum de Florence, est destinée aux pires criminels des États-Unis et est considérée comme la plus dure et la plus inexpugnable du pays ? Ici les prisonniers n'ont pas de contact entre eux, c'est un labyrinthe d'acier et de ciment construit pour isoler et annihiler. J'ai été parmi les hommes qui ont inauguré ce pénitencier.
Pour n'importe quel habitant de Porto Rico, vivre loin de la mer est une chose incompréhensible. Et c'est bien différent quand on est en liberté de se mouvoir n'importe où et de voyager à sa rencontre. Peu importe qu'elle soit grise et froide, même si tu rencontres la mer dans un pays lointain, tu te rends compte qu'elle est “toujours recommencée", comme l'écrit un poète (note du traducteur : il s'agit probablement d'une allusion au poème de Paul Valéry: Le cimetière marin), et qu'à travers elle peuvent passer des poissons qui s'approcheront de ta terre et venant de là-bas, t'apporteront des souvenirs
J'ai appris à nager très jeune, je devais avoir trois ans. Un cousin de mon père qui vivait avec nous était pour moi comme un frère aîné, il m'avait emmené à la plage où il avait l'habitude de nager avec ses amis, il me lançait à l'eau pour que j'apprenne. Après cela quand j'étais à l'école, j'avais l'habitude de faire des escapades avec d'autres garçons jusqu'à une rivière proche, tout cela me paraît bien loin.Ici dans la prison, j'ai ressenti bien des fois la nostalgie de la mer. L'envie de la prendre à plein poumons, de la toucher, de m'inonder les lèvres, mais tout de suite je me rends compte qu'il se passera sans doute bien des années avant de pouvoir accéder à ce plaisir bien simple.La mer me surprend toujours, mais je crois que je n'ai jamais eu autant besoin d'elle que le jour où l'on m'a transféré de la prison de Marion, dans l'Illinois, à celle de Florence, dans le Colorado. A Marion, je pouvais sortir dans la cour une fois par semaine, et de là, je voyais les arbres, les oiseaux… j'entendais le bruit du train et le chant des cigales…je courais sur la terre, je la sentais, je pouvais agripper l'herbe et laisser les papillons m'entourer…mais à Florence tout cela s'est terminé.Sais-tu que la ADX, c'est à dire la prison de sécurité maximum de Florence, est destinée aux pires criminels des États-Unis et est considérée comme la plus dure et la plus inexpugnable du pays ? Ici les prisonniers n'ont pas de contact entre eux, c'est un labyrinthe d'acier et de ciment construit pour isoler et annihiler. J'ai été parmi les hommes qui ont inauguré ce pénitencier.
Quand
je suis arrivé, on me réveillait plusieurs fois la nuit et pendant longtemps je
n'ai pas réussi à dormir plus de 50 minutes à la fois. Nous étions alors
seulement quatre prisonniers dans cette galère, mais l'un d'entre eux avait un
long passé de problèmes mentaux et criait des obscénités jour et nuit en
luttant contre des ennemis invisibles. Nous étions presque tout le temps dans
les cellules, même pour les repas. Tout le mobilier était en béton, on ne
pouvait rien bouger. Je ne comprends pas comment nos voisins, la population de
Florence, avait accepté une prison tellement inhumaine auprès d'elle. Pourtant
je sais que de nos jours l'industrie des prisons est très puissante au USA,
cela rapporte de l'argent et il semble que ce soit uniquement ce qui importe!A
Florence, la nuit les prisonniers communiquaient au travers d'une bouche de ventilation
qui était au plafond. Il fallait crier pour se faire entendre, tous criaient,
et cela ne faisait que nous épuiser mentalement.
Moi,
je me taisais, j'essayais de me concentrer sur le bruit des vagues, en fermant
les yeux je les voyais se briser sur le sable devant la grotte de l'indien, la
clameur de la prison commençait progressivement à disparaître. La mer montait
et s'abaissait comme un torse en me transmettant sa force et sa respiration.Je
sais qu'un jour je passerai devant elle toute une nuit et j'y attendrai
l'arrivée du jour. Ensuite je voudrais faire la même chose à Jayuya, voir le
coucher du soleil sur la Cordillère….
Sur
cette espérance, en résistance et lutte, ton grand-père t'embrasse !
Troisième
lettre: “ Le sens de tout combat"
Je voudrais te dire aujourd'hui que la vie est pleine
de défis et parfois de déceptions. Ne permet jamais à rien ni à personne de te
décourager parce qu'il y a en toi la force pour affronter et dominer n'importe
quel obstacle.
Dans ce monde bien dur pour un garçonnet portoricain
qui pouvait à peine s'exprimer en anglais, j'ai pourtant rencontré une poignée
de personnes merveilleuses.
J'ai eu, par exemple une enseignante formidable au
Collège Wright, un établissement préuniversitaire où j'ai pu aller à la fin de
mon cycle secondaire. Nous étions pauvres, je peux te dire que j'avais honte de
mes habits moches et usés et de mes vielles chaussures de tennis, les seules
que je possédais, et pourtant, cette femme excellente qui donnait des cours de
prononciation, ne s'intéressait pas aux apparences. Elle m'a accordé beaucoup
de temps avec patience et douceur, elle s'est aperçue que je bégayais quand je
parlais anglais et m'a proposé une solution en me faisant faire des exercices
et des lectures. A cette époque, j'ai commencé à passer mon temps libre dans un
quartier de Chicago où traînaient les "beats", un groupe d'écrivains
et d'artistes très épris de liberté.
Oscar Lopez Rivera.
Quatrième
lettre : “ Une ombre furtive”
Chère Karina,
Ces jours-ci, je me suis souvenu d'un épisode qui je
crois a marqué ma vie. Il est curieux de constater que notre mémoire puisse
parfois isoler, de toutes les horreurs que nous voyons, un fait bien précis,
non pas le plus sanglant ou le plus douloureux, mais celui qui s'imprime pour
toujours en notre âme et ressuscite lorsque nous prenons de l'âge.
J'avais ton âge quand j'ai été appelé pour
me battre au Vietnam. Je suis entré dans la guerre au mois de mars 1966.
On m'a envoyé à la base de Lai Khe, mais je n'y
suis resté que peu de jours car j'ai été rapidement envoyé sur des opérations
itinérantes presque toujours autour de Saïgon et qui duraient des
semaines.
C'est dans les environs de cette base de Lai Khe que
j'ai constaté pour la première fois les effets dévastateurs du fameux
"agent orange", ce défoliant utilisé pour détruire la forêt était
conservé dans des barils avec une bande orange et les avions arrosaient ce
produit qui paraissait aussi inoffensif que les traitements agricoles aériens.
En réalité l'effet était terrible, toutes les plantes séchaient et mourraient
en l'espace de trois jours, toute la végétation était mise à plat, noircie,
transformée en un amas où il était difficile de distinguer des ossements
animaux ou humains!
Un jour, ils ont demandé à notre peloton d'encercler
un village, on a établi un périmètre avec des points de contrôle empêchant
toute entrée ou sortie de personnes. On est resté comme ça six semaines à
surveiller les paysans qui cultivaient le riz. Ils travaillaient avec de l'eau
à mi-jambe, toujours sous notre surveillance. L'un d'eux qui était de mon âge,
s'est approché de moi, un soir après le travail, a placé son bras à côté du
mien en disant:" same thing" (la même chose). J'ai regardé nos
bras et j'ai découvert, à ma grande surprise que nous avions tous les deux les mêmes,
secs et durs au travail!
Quelques nuits plus tard, une sentinelle a remarqué
des mouvements et des ombres suspectes autour de notre campement. Elle a donné
l'alerte, nous sommes arrivés en courant, on nous a donné l'ordre d'ouvrir le
feu et une pluie de balles a balayé le feuillage; quand on nous a donné l'ordre
de cesser le feu, nous sommes restés paralysés, n'osant pas respirer. L'ombre
suspecte a recommencé à bouger dans la végétation, le chef du peloton nous a
ordonné de tirer de nouveau, nous avons visé de nouveau et envoyés une pluie de
balles, rien ne bougeait plus mais nous n'avons pas été tranquilles jusqu'à
l'aube. Quand la clarté a commencé à apparaître, on a entendu des cris
déchirants qui provenaient des rizières et nous nous y sommes précipités. Il y
avait là trois ou quatre paysans qui pleuraient devant le cadavre d'un buffle,
le seul de tout le village qui pouvait travailler la terre. Cet animal était
l'ombre furtive et silencieuse que nous avions tuée!
Le plus jeune parmi les hommes qui pleuraient, était
ce garçon qui avait posé son bras à côté du mien, il avait ses vêtements et sa
peau maculés du sang du buffle et me regardait fixement..... une partie du
peloton a ensuite été transféré vers une zone parsemé de mines et de ces pièges
que l'on appelait des "booby traps" qui ont blessé beaucoup d'entre
nous. Sur les 31 hommes de mon groupe 17 ont été mis hors de combat. Nous
passions beaucoup de temps à essayer de localiser ces pièges et nettoyer le
terrain pour que les hélicoptères descendent pour ouvrir un passage aux équipes
récupérant les victimes.
. Ce garçon qui pleurait son buffle et devait
avoir mon âge ne pourrait pas imaginer, s'il vit encore, que je suis prisonnier
depuis 32 ans et que j'ai très souvent pensé à lui...Il avait raison, son bras
et la mien étaient la même chose.
En résistance et lutte, ton grand-père t'embrasse.
Oscar López Rivera
Cinquième
lettre : “L'histoire de Jíbara Soy”
hère Karina:
J'ai entendu parler il n'y a pas longtemps d'un chien
qui aboyait trop près d'une maison de Santurce. Il est mort sous les balles et
je n'ai pu m'empêcher de penser aux chiens qui m'ont accompagnés dans la vie,
qui étaient à mes côtés pour le meilleur et pour le pire, jusqu'au jour même où
l'on m'a arrêté m'accompagnant alors de leur regard paisible. Il y a toujours
eu un chien à mes côtés, enfant à San Sebastian et ensuite dans ma jeunesse
quand j'ai migré aux Etats-Unis et même au Vietnam où ils ont soufferts les
horreurs de la guerre. Cette proximité d'un animal aussi noble, capable de te
comprendre, de partager ta nostalgie et ta tristesse m'a beaucoup manqué en
prison.
En 1973, quand je vivais à Chicago, j'ai eu une
chienne formidable, un Pincher Doberman qui s'appelait Jibara Soy. C'était la
mascotte du quartier, intelligente et protectrice, qui voulait toujours attirer
l'attention. A cette époque, je louais un petit appartement là même où mon
frère ainé avait sa maison. Une des conditions imposées était que je n'y emmène
pas de chien, mais il se trouve qu'une nuit des voleurs sont entrés et j'ai finalement
convaincu mon frère d'accepter la présence de ma chienne. Quelques semaines
après, m'étant absenté quelques heures, je suis rentré pour constater que
Jibara Soy avait transformé le beau jardin que mon frère entretenait avec un
soin extrême en un véritable champ de bataille. Elle avait fait d'énormes trous
desquels elle avait extrait des rats de la taille d'un chat. Je l'ai lavé, je
l'ai emmené au vétérinaire pour m'assurer qu'elle ne s'était pas blessé,
qu'elle ne risquait pas de contracter une maladie. De retour à la maison, j'ai
fait ce que j'ai pu dans le jardin pour réparer les dégâts....Quand mon frère
est rentré du travail, je lui ai dit que j'avais deux nouvelles à lui annoncer:
une bonne et une mauvaise. La bonne était que Jibara Soy avait tué neuf rats,
la mauvaise, il pouvait la constater de ses propres yeux, le jardin était
ravagé, il faudrait mettre les bouchées doubles pour lui redonner sa verdeur.
Mon frère et son épouse se sont finalement pris de
tendresse pour ce chien qui nous a accompagnés de longues années. Il avait
son fauteuil à lui où il écoutait avec attention la musique classique, et
chaque fois que je me mettais à lire il avait les yeux rivés sur moi comme
s'il était capable de lire mes pensées et découvrir la signification du texte.
Et puis un jour elle est morte en donnant le jour à 16
chiots. J'avais cru jusque-là qu'elle avait simplement grossi car le
vétérinaire lui donnait des pilules contraceptives, mais ça n'a apparemment pas
fonctionné...Ta mère, Clarissa, est une grande amoureuse des animaux, tu as toi-même
vécu parmi eux, tu peux comprendre combien il m'a été difficile de perdre mes
animaux le jour où ils sont venus m'arrêter. Je vivais dans la clandestinité,
ils étaient mes compagnons en situation de désespoir! Un jour on a
découvert ma cachette, on est venu m'arrêter, je te dirai plus tard mes
sentiments et mes peurs quand ils m'ont emmené, mais je sais seulement que ce
jour de mai 1981 quand cet agent du FBI s'est approché de moi, la première
chose que je lui ai demandé, c'est ce qu'il avait fait de mes chiens! Il m'a
répondu qu'ils avaient été emmenés au ASPCA, un refuge animalier, mais quelque
chose dans son expression m'a fait comprendre qu'il mentait, j'ai insisté pour
savoir la vérité...Il y a eu un long silence que je n'ai que trop compris et
j'ai entendu ce que je craignais:" Nous avons dû les abattre".
Quand je repense à la fidélité de ces deux chiens, il
me revient à la mémoire le souvenir de tous ceux que j'ai eu depuis mon enfance
à San Sebastien de Portorico, des malheureux chiens massacrés du Vietnam, il me
semble encore entendre les aboiements courageux de Jibara Soy. 32 années sont
passées, j'aime les animaux que j'ai perdu, ceux qui furent mien et n'ont pu
mourir avec des paroles apaisantes et mes mains caressantes....J'aime déjà ceux
que j'aurai un jour à Porto Rico.
Ton grand père, en résistance et lutte,
Oscar López Rivera
Sixième lettre:" Pour devenir ce que nous
sommes"
Ma chère Karina,
Voici un bel exemple de lutte: A la fin des années
soixante, il y avait beaucoup de plaintes pour discrimination
envers les latinos dans une entreprise de téléphonie de Chicago qui s'appelait
"Illinois Bell". Nous nous sommes rassemblés en collectif pour nous
défendre dans la basse ville où se trouvait alors le siège de l'entreprise.
Son président était alors un certain Charles Brown, il
ne nous autorisait un contact que par l'intermédiaire d'un de ses adjoints, un
latino- péruvien qui n'avait en réalité aucun pouvoir.
Un jour, nous avons su que Mr Brown avait l'habitude
de fréquenter une église presbytérienne à Lake Forest, une banlieue chic.
Nous y sommes allés, il y a eu un problème, Mr Brown était absent ce
jour-là! Nous nous somme placés devant le pupitre et nous avons expliqué au
public que tout ce que nous voulions, c'était parler avec cet homme, lui
exposer nos problèmes car, dans son entreprise on excluait les latinos. Ceci
dit, nous les avons remerciés et nous sommes retirés. Peu de temps après, alors
que nous rentrions chez nous, une des personnes qui étaient dans l'église, nous
a contactés pour nous donner l'adresse de Mr Brown. Quelques-uns d'entre nous
sont alors retournés à Lake Forrest pour repérer les lieux et plusieurs
semaines après, nous avons loués des bus, nous y sommes montés avec nos
familles pour aller manifester de nouveau, mais cette fois en face de chez lui,
nous avions dit aux enfants que nous allions piqueniquer et chacun avait son
petit repas agrémenté de quelques douceurs.
A cette époque, il n'y avait pas de contrôle pour
rentrer dans les quartiers de luxe et même pas de portails. Nous nous sommes
assis autour de la piscine et il a été impossible d'empêcher les enfants de
sauter dans l'eau. Alors nous avons vu qu'une porte de la maison s'ouvrait,
c'était Mr Brown lui-même qui nous invitait à entrer. Dix d'entre nous se sont
approchés pour la discussion qui a eu lieu dans la cuisine de la maison. A un
certain moment, il s'est excusé puis il a appelé son fils qui connaissait
l'espagnol pour qu'il serve d'interprète. Nous lui avons dit que ce
n'était pas nécessaire, que nous étions tous bilingues. Alors, il nous a tous
donné rendez-vous pour le matin suivant dans son entreprise et nous nous y sommes
retrouvés. Il a donné son accord pour l'embauche immédiate de 125 travailleurs
latinos dans divers services de la Illinois Bell et l'ouverture de deux bureaux
pour des communautés hispanique, une pour les mexicains et une pour les
portoricains de manière à leur offrir des services en langue espagnole. Il a
accepté également d'embaucher chaque année un certain nombre d'ouvriers
latinos.
Cet accord obtenu auprès de Mr Brown a été pour nous
une grande victoire, et quasi spontanément, nous avons créé " l'alliance
hispanique du travail".
Peu à peu, nous avons étendu notre action à la défense
des droits des ouvriers d'autres entreprises, surtout dans le domaine de la
construction immobilière. Nous avons exigés que l'on emploie des travailleurs
latinos et nous avons eu le plaisir de voir nos demandes satisfaites. Il n'y a
jamais eu de violence, seulement une demande de plus de travail, et une grande
mobilisation communautaire planifiée dans les moindres détails.
Finalement on a vu les portes des entreprises et des
unions ouvrières jusque-là fermées commencer à s'ouvrir pour nous.
Ensuite, tout l'effort a été concentré sur les écoles
et les universités. J'estime que pour être ce que nous sommes, il faut
consentir des sacrifices de toute sorte.
Je
ne t'ai peut-être jamais aidé à souffler les bougies de tes anniversaires comme
le font tellement de grand-père pour leurs petites filles, mais je me console
en pensant que j'ai posé mon grain de sable pour construire un monde plus
lumineux et juste pour toi.
En résistance et lutte, Oscar López Rivera t'embrasse.
Septième lettre : “Tous ont écouté"
Chère Karina,
Lorsque je t'ai raconté la lutte des Latinos contre la
discrimination au travail, je me souvenais de mon premier effort pour organiser
une manifestation. Beaucoup d'immigrants portoricains vivent dans des
conditions infrahumaines, dans des logements envahis par les rats, avec des
escaliers dangereux et des toits qui partent en morceaux. Les propriétaires ne
se sont jamais préoccupés de les entretenir, mais n'oublieront jamais de
récupérer les loyers chaque mois, rendant la vie impossible à tous ceux qui ont
des retards.
J'ai ainsi commencé à rencontrer les personnes qui
vivaient dans les conditions les plus misérables, frappant aux portes pour
essayer de les organiser. La première femme avec qui j'ai parlé m'a dit:"
Qui écoutera une portoricaine"?, la réponse m'est sortie du cœur:"
Moi, je 'écouterai et ensuite, tous les deux, nous irons écouter les autres, et
finalement tous écouteront tout le monde"!
Je l'ai convaincu et nous avons commencé à discuter
avec les autres locataires. Nous voulions seulement que le bâtiment sois
nettoyé, les canalisations et les rampes diverses réparées, et bien sûr
que soit éliminé la multitude de rats et bestioles diverses avec lesquels tant
de famille devaient vivre.
Les portes de la banque ont été libérés et les enfants
se sont réjouis en envoyant les petites pièces en colère, c'est une grand-mère
portoricaine qui avec ses deux petits enfants étaient en tête de la
manifestation contre la banque, au retour, ses yeux brillaient plus que le
reflet du soleil dans les pièces de monnaie.
Nous nous sommes écoutés les uns les autres, faisant ainsi naître une forte
solidarité.
En
résistance et lutte, ton grand-père
Oscar López Rivera
Huitième lettre: “ face à face avec la peur”
Ma chère Karina,
Oscar López Rivera
Huitième lettre: “ face à face avec la peur”
Ma chère Karina,
Chacun décide de son destin et risque son âme en
fonction de ce que lui dicte sa conscience. La peur est toujours là à
chaque moment, jour et nuit, mais on peut apprendre à l'utiliser à son profit.
Au Vietnam par exemple c'est la peur qui m'a aidé à être prudent, attentif à
tout ce qui m'entourait, aux mouvements et aux sons inhabituels. Pendant des
mois, des années, j'ai survécu comme cela, humant l'air pour pouvoir
détecter le danger. Quand arrivait au bataillon un nouveau soldat et que je le
voyais présumer de ses forces et de sa vaillance, je commençais par l'observer.
Je me rendais souvent compte que cette attitude avait pour but d'impressionner
les autres et de cacher la panique qui l'assaillait. Alors, quand le combat
arrivait, c'était de deux choses l'une: ou il était totalement paralysé, ou il
avait un comportement dangereusement téméraire. Dans les deux cas, je finissais
par le prendre à part et lui et lui expliquer que tous, nous avions peur, que
c'était un sentiment normal. L'important était de le reconnaître, de
l'accepter, parce que se retrouver paralysé ou trop téméraire dans le feu du
combat mettait sa vie et celle de ses compagnons en danger.
Je pense que le fait d'avoir grandi sur les
trottoirs de Chicago a été pour moi un bon apprentissage du contrôle de ma
peur.
Des années plus tard, quand on m'a envoyé à la prison
de Marion et que j'y ai expérimenté ce qu'on appelle le "régime de
privation sensorielle", je n'avais aucune idée de ce qui allait
m'arriver ou des personnes avec lesquelles j'allais vivre. On m'a placé dans
l'unité "gang" au milieu d'une brochette des plus dangereux du pays.
Personne ne peut honnêtement dire qu'il ne craint pas pour sa vie dans un tel
lieu. Il se trouve que j'ai reconnu quelques-uns des détenus qui s'étaient trouvés
avec moi dans la prison de Leavenworth, ils se sont montrés solidaires, ils
savaient que je ne venais pas d'un gang, que j'étais un prisonnier politique.
J'ai su très vite que j'aurai seulement droit à un
quart d'heure par mois de téléphone, en pratique beaucoup moins car les appels
étaient souvent coupés. Ma peine s'en trouvait alourdie car ma mère était âgée
et malade et c'était elle qui maintenait ma relation avec mes frères et le
reste de ma famille à Porto Rico.
Le plus douloureux a été pour moi de ne pas pouvoir
parler suffisamment avec ma fille qui était alors encore un enfant. Comme elle
ne me connaissait presque pas, elle ne me disait pas grand-chose au téléphone.
Quand j'avais des visites, les contacts physiques m'étaient interdits. Je me souviens
encore de la première fois que Maman, ton arrière-grand-mère, est
venue me voir…elle a éclaté en sanglot en me voyant exposé derrière la vitre.
Je lui ai dit tout de suite qu'il fallait qu'elle soit forte, qu'elle retienne
ses larmes pour ne pas montrer aux geôliers que ce régime carcéral abattait
toute la famille. Par la suite, elle n'a plus pleuré en ma présence et s'est
comporté comme une portoricaine courageuse.
A la différence de Leavenworth, dans cette prison de
Marion, on interceptait toute ma correspondance et ce qu'on m'envoyait à lire.
Il se passait parfois des semaines ou des mois avant que l'on me donne mes
lettres, revues ou journaux. Ils me donnaient tout en même temps et le jour
suivant quelqu'un entrait dans ma cellule pour vérifier tout ou confisquer tout
ce que je n'avais même pas encore lu sous le prétexte qu'ils appelaient "
excès de papier". Il m'est arrivé de partager les journaux dès qu'on me
les donnait entre tous les autres détenus qui me les rendaient progressivement.
La presse n'était pas souvent récente, mais je lisais tout.
Il
faut toujours lire, Karina, la lecture aussi est utile pour soulager la solitude
dont je te parlerai plustard.
En résistance et lutte, ton grand-père
Oscar López Rivera
Oscar López Rivera
Neuvième lettre: “ Un air de liberté en plein visage”
Chère Karina,
Il y a quelques nuits, peut-être par ce que je t'avais
écrit avant de me coucher, j'ai fait un rêve: tu étais là avec ta mère, nous
étions tous les trois face à l'océan, celui que j'aspire plus que tout à voir,
là où les vagues se brisent contre la grotte de l'indien.
Comme je te raconte cela, tu dois te demander de quoi
rêvent les personnes qui ont été privées de liberté pendant tellement
d'années…. est-il possible que bien qu'enfermés, nous nous obstinions à rêver
des rues de la lumière et des visages qui nous sont interdits. Pour moi,
pendant les premières années, mes types de rêves ont été les mêmes qu'avant la
prison, mais tout a changé quand je me suis retrouvé sous le régime de
"privation sensorielle". Mes rêves sont devenus angoissants,
décousus, fugaces. L’isolement et la solitude absolu altère la qualité du repos
nocturne. Après cette épreuve, je n'ai plus jamais connu un sommeil relaxant et
profond. Lorsque toi ou ta mère Clarisa apparaissent encore dans mes
songes, c'est pour un temps très court, de temps en temps il y a des bribes de
conversation, la même chose se produit avec d'autres personnes de ma famille ou
mes amis.
Dans l'obscurité de la cellule, la solitude frappe doublement. C'est dur de ne pas pouvoir partager mes idées, mes pensées et mes épreuves avec d'autres qui sont dans la même situation que moi…Tu sais ce qui m'a manqué le plus? C'est de ne pas pouvoir discuter d'un livre que je venais de lire, ça semble banal, insignifiant au milieu des épreuves qu'impose la solitude, mais c'est bien vrai!
Il y a quelques années j'aimais beaucoup résoudre des problèmes de mathématiques et je lisais tout ce que je pouvais sur ce thème. Il pouvait m'arriver de rencontrer un prisonnier aussi intéressé lui aussi par les maths et c'était pour nous deux un moment de plaisir, mais cela arrivait bien peu souvent.
Aujourd'hui je passe des heures à me demander comment résoudre d'autres problèmes : la violence entre les communautés, l'absentéisme scolaire, la corruption… il est difficile d'échanger des idées par correspondances, on aspire à des réactions immédiates, un dialogue fécond avec l'autre!
J'ai aimé lire toute ma vie, j'ai apprécié le plaisir de la lecture solitaire, par cela peut-être les rigueurs du "confinement" m'ont été supportables, surtout dans ce qu'ils appellent "l'isolement. Avec le temps, je me suis rendu compte que la seule manière de survivre et de se maintenir occupé. Évidemment, il y a des moments de mélancolie sous la morsure de la solitude, mais j'arrive à éloigner assez vite ces nuages noirs de ma tête et penser à autre chose.
Dans l'obscurité de la cellule, la solitude frappe doublement. C'est dur de ne pas pouvoir partager mes idées, mes pensées et mes épreuves avec d'autres qui sont dans la même situation que moi…Tu sais ce qui m'a manqué le plus? C'est de ne pas pouvoir discuter d'un livre que je venais de lire, ça semble banal, insignifiant au milieu des épreuves qu'impose la solitude, mais c'est bien vrai!
Il y a quelques années j'aimais beaucoup résoudre des problèmes de mathématiques et je lisais tout ce que je pouvais sur ce thème. Il pouvait m'arriver de rencontrer un prisonnier aussi intéressé lui aussi par les maths et c'était pour nous deux un moment de plaisir, mais cela arrivait bien peu souvent.
Aujourd'hui je passe des heures à me demander comment résoudre d'autres problèmes : la violence entre les communautés, l'absentéisme scolaire, la corruption… il est difficile d'échanger des idées par correspondances, on aspire à des réactions immédiates, un dialogue fécond avec l'autre!
J'ai aimé lire toute ma vie, j'ai apprécié le plaisir de la lecture solitaire, par cela peut-être les rigueurs du "confinement" m'ont été supportables, surtout dans ce qu'ils appellent "l'isolement. Avec le temps, je me suis rendu compte que la seule manière de survivre et de se maintenir occupé. Évidemment, il y a des moments de mélancolie sous la morsure de la solitude, mais j'arrive à éloigner assez vite ces nuages noirs de ma tête et penser à autre chose.
Le simple fait de m'autoriser aujourd'hui un bref
appel téléphonique, un courrier électronique, une visite rend ma situation
actuelle plus supportable que les années d'isolement total.
En ce qui concerne la question que tu m'as posée sur mon futur, je te répondrai que la nuit dans les dédales de l'insomnie, je fixe parfois le plafond de la cellule en me demandant ce que je voudrais faire. Le futur est pour moi quelque chose d'imprévisible, mais la peur ne fait pas partie d'un futur hors de ce Goulag. Je ne me demande même pas si je vais me sentir coincé, si la réalité me semblera étrange, ou si je me retrouverai face à un monde difficile à reconnaître. Il est certain que Porto Rico a changé, le Chicago de mon adolescence également, mais lorsque je me réveille la nuit, je prends courage en me disant que finalement j'ai survécu 70, frôlant souvent la mort. Comment l'homme qui a vécu cela pourrait-il s'effrayer d'un air de liberté qui lui arrive en plein visage!
En ce qui concerne la question que tu m'as posée sur mon futur, je te répondrai que la nuit dans les dédales de l'insomnie, je fixe parfois le plafond de la cellule en me demandant ce que je voudrais faire. Le futur est pour moi quelque chose d'imprévisible, mais la peur ne fait pas partie d'un futur hors de ce Goulag. Je ne me demande même pas si je vais me sentir coincé, si la réalité me semblera étrange, ou si je me retrouverai face à un monde difficile à reconnaître. Il est certain que Porto Rico a changé, le Chicago de mon adolescence également, mais lorsque je me réveille la nuit, je prends courage en me disant que finalement j'ai survécu 70, frôlant souvent la mort. Comment l'homme qui a vécu cela pourrait-il s'effrayer d'un air de liberté qui lui arrive en plein visage!
En résistance et lutte, ton grand-père reconnaissant:
Oscar López Rivera
Dixième lettre: “la danse du souvenir”
Ma chère Karine je viens de me souvenir que le grand
musicien Andy Montañez possède un portrait que j'ai fait il y a pas mal de
temps dans lequel vous vous trouvez tous les deux, toi à côté de lui, je
vous admire tous les deux pour des raisons différentes:
Andy, pour des raisons évidentes, il est une véritable
institution pour la musique de mon pays, il a su rester fidèle à ses principes,
il est un artiste courageux.
Sais-tu pourquoi je n'ai jamais voulu entendre parler
de ma "libération": Mais c'est parce que je suis libre, Karina, et la
musique a beaucoup contribué à cette liberté. Je préfère que l'on dise
"mon excarceration" car la liberté, je ne l'ai jamais perdue.
Mes goûts musicaux ont toujours été éclectiques,
j'aime des genres très différents, mais la musique portoricaine me touche plus
que tout autre. J'ai commencé à danser la Salsa il y a très longtemps avant
qu'elle s'appelle Salsa. La première fois que Cortijo et son groupe Combo
arrivèrent à Chicago, un de mes oncles m'a proposé d'aller les voir. Evidemment
on y est allé, à cette époque je ne savais pas danser, mais comme un bon garçon
portoricain j'ai invité une fille qui finalement a été déçue par mon manque
d'aptitude. Après cette affaire, je me suis mis à apprendre progressivement et
seul pour la prochaine fois où j'irai à un bal. Honnêtement je n'étais pas
précisément le cavalier dont rêvaient ces demoiselles!
Je pense souvent à cette femme en écoutant cette
musique, je regrette un peu d'en avoir déçu d'autres en dansant comme je le
faisais au début, et d'avoir fait passer de salles nuits aux voisins quand on
organisait des bals bien bruyants les week-ends jusqu'à l'aube….
Je n'ai plus eu le loisir de danser quand je suis entré dans l'action sociale et la lutte politique. Je fredonne toujours les chansons de ma jeunesse, je crois encore que la musique et la danse nous offre une liberté, celle de la mémoire.
En
résistance et lutte, ton grand-père
Oscar López Rivera
Onzième lettre: “ Une prière dans les
barbelés”
Chère Karina,
Connais-tu George Stinney, un garçon de 14 ans qui est
mort sur la chaise électrique pour un crime qu'il semble ne jamais avoir
commis? Il a été le plus jeune prisonnier à subir la peine de mort aux
Etats-Unis pendant l'année 1944. Il y a aujourd'hui un mouvement intéressant
qui s'organise pour obtenir un réexamen de son cas.
Ce Stinney qui était mince et petit a dû être assis
posé sur un livre, la chaise électrique n'était pas adaptée à sa taille mais
construite pour tuer des adultes!
Sa situation n'a fait alors qu'empirer, confronté au
personnel des prisons, spécialement à un capitaine portoricain qui sachant
qu'il avait frappé un autre gardien lui rendit la vie impossible. Finalement,
considéré comme incorrigible, il s'est retrouvé à Marion, dans l'unité ou je me
trouvais. Un jour, le voyant très déprimé, je lui ai donné un crayon et un
papier et je me suis rendu compte qu'il était capable de dessiner très bien. Il
suffisait d'un peu de patience et de le laisser s'exprimer.
Malgré cela il montrait des signes évidents de
troubles mentaux, de temps en temps il affirmait que le "Dieu " qui
parlait dans sa tête lui demandait de faire ceci ou cela. Je voyais bien que
quelque chose n'allait pas, mais je le stimulais, le poussais à lire, à
dessiner pour se calmer. Il ne recevait aucune aide psychologique ou médicamenteuse.
Et puis, un jour, il est venu me dire que
"Dieu" lui avait ordonné de quitter la prison! Je lui ai dit de
ne pas faire cette folie, qu'il était bon qu'il récite et lise la bible
mais qu'il devait avant tout se concentrer sur ses aspirations profondes
et développer son talent pour dessiner.
Le jour suivant, nous étions dans la cour, il y a eu
une grande agitation et des cris, on a vu le garçon qui avait réussi à briser
un portail. Il l'avait fait si rapidement que personne ne s'en est rendu compte
sur le coup. Depuis les tours de guet, les gardes ont vu qu'un homme essayait
de s'enfuir, et nous avons tous levé la tête, il était au-dessus de
nous, pris dans les barbelés, à genoux et les mains jointes comme
s'il priait. Je m'en souviens et mon cœur se brise. J'ai tout de suite vu que
sa tenue de prisonnier devenait peu à peu rouge, rouge de sang. On nous a
ordonné de quitter immédiatement la cour et nous nous sommes retrouvés dans nos
cellules. J'ai su qu'il a fallu un quart d'heure aux gardiens pour déloger
le garçon de l'endroit où il se trouvait. Une heure après, j'ai entendu à la
radio qu'une tentative d'évasion venait d'échouer à la prison de Marion.
Un des gardiens m'a dit par la suite
que lorsqu'ils ont réussi à le récupérer, tout son corps était couvert de
blessures et qu'il avait été envoyé dans une autre prison aussi dure mais
avec des criminels beaucoup plus âgés que lui!
Quand je pense que le juge avait recommandé un
placement avec assistance alors qu'il se retrouvait maintenant dans un trou
sordide, encore plus impitoyable que n'importe quel goulag...
Toi, Karina, soit toujours forte devant n'importe quelle réalité.
Oscar López Rivera
Douzième lettre: “Une fenêtre idéale”
Ma chère Karina,
Je regarde rarement la télévision, mais le jeudi 21
novembre 2013, par le plus grand des hasards, je regardais les Grammy's Latinos
avec d'autres prisonniers.
Et là, j'ai entendu Ricky Martin s'écrier «
Justice et liberté pour Oscar López!», j'ai tremblé d'émotion et de gratitude
car Ricky est un homme courageux dont la voix est respecté. A cet instant j'ai
pensé à la marche qui était prévue le samedi 23 novembre, un évènement pour moi
extraordinaire. Je ne savais pas tout le travail de préparation qui
se faisait, mais je pressentais un grand rassemblement.
Ce samedi-là, quand j'ai pu appeler ta mère, elle m'a
dit que ce qui se préparait était incroyable, la marche n'était pas encore
commencé et j'ai attendu un moment avant de l'appeler de nouveau, ça m'a semblé
interminable mais je voulais utiliser le peu de temps qui m'était accordé au
téléphone au moment où la manifestation battrait son plein.
Et ça a marché, quand j'ai eu Clarissa de
nouveau, j'ai pu entendre la musique et les slogans des manifestants! Je ne
peux pas te dire l'émotion qui envahie une personne emprisonnée depuis si
longtemps lorsqu'elle se rend compte que des milliers d'hommes et de
femmes, sous le soleil, dans les rues au grand air, sont là, ensemble, pour
demander que s'ouvrent les barreaux et que tu puisse te joindre à
elles! C'est en même temps une joie et une douleur indescriptible. Il
te manque le soutien, la proximité immédiate de ces gens, tu voudrais les
embrasser tous et tu es triste de ne pouvoir le faire. Un peu plus tard j'ai
parlé avec Jan Susler qui était dans le groupe et grâce à son téléphone, j'ai
pu saluer plusieurs personnes qui marchaient avec lui. Il y en avait que je
connaissais depuis longtemps, d'autres non, mais peu importe, mon émotion était
forte au contact de tellement de personnes qui avaient sacrifié leur
après-midi de samedi pour demander mon "excarcération".
Cet enthousiasme a été contagieux, j'ai parlé avec
Nydia Velázquez y Luis Gutierrez, tous deux membres du Congrès, qui ont promis
de venir me rendre visite, Comment puis-je les remercier pour leur geste,
pour les pétitions qu'ils ont organisés en faveur de ma sortie
En entendant ces voix, j'ai compris combien la parole
est une fenêtre idéale pour contempler le monde extérieur. Par cette parole,
par tout ce qu'on me racontait, j'ai "vu" le merveilleux de ce
spectacle qu'ils ont organisé. En vérité, je crois que cette marche a validé
tous les efforts déployés pendant cette année pour essayer de me sortir de
prison. C'est aussi une belle illustration de la bonté et la noblesse de
l'âme portoricaine.
Je suis fier de savoir que pour moi, des milliers de
personnes, oubliant leurs différences politiques ou religieuses, se sont
assemblées, toutes générations confondues. Quand je vois les photos, ça me fait
penser à une gigantesque couverture en patchwork, des morceaux de tissus
différents mais qui s'assemblent tous dans un même but: protéger l'être humain.
Oui, je me suis senti protégé.
Je me suis amusé comme un enfant en regardant les
papillons Monarque, création d'un artiste portoricain. Imagine-toi, Karina, que
cette espèce de papillon parcoure des milliers de kilomètres depuis le Canada
ou le Minnesota pour venir se poser dans des forêts d'Oyamel, une espèce
d'arbre présente au Mexique.
Pour une fois,
ces papillons ont volé dans une direction différente, depuis Porto Rico jusqu'à
ma prison. Toute cette marche, du début à la fin, ce peuple qui clame la liberté
et la justice, ont rempli ma pauvre vie d'espérance!
Témoignage du courage pour penser autrement, preuve
que le plus petit des enfants est capable de participer à la recherche d'une
vie meilleure, vers la décolonisation du pays, et surtout de nos esprits....
Je garderai en mémoire jusqu'à mon dernier jour le souvenir de cette marche du 23 novembre..
En résistance et lutte, ton grand-père, le cœur plein d'émotion.
Je garderai en mémoire jusqu'à mon dernier jour le souvenir de cette marche du 23 novembre..
En résistance et lutte, ton grand-père, le cœur plein d'émotion.
Oscar López Rivera
CARTAS DE OSCAR LÓPEZ RIVERA A SU NIETA
Aún no sé como le haré justo homenaje a este hombre de palabra pura y corazón inmenso. Pero en lo que llega la epifanía (Elaine y su mashup son insuperables) sumaré las cartas que sábado tras sábado publicará El Nuevo Día, cartas que escribió Oscar López Rivera a su nieta, quien solo puede construirse una imagen de su abuelo a través de estas letras. Escribiéndole a ella, dice, “siento que les hablo a miles de jóvenes puertorriqueños, para quienes mi nombre apenas significa nada”. Un verdadero monumento al amor, a la valentía.
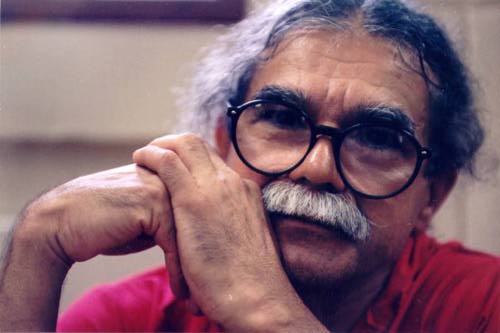
Carta I: “Las manos en el cristal”
Querida Karina, No ha sido fácil escoger un título para estas cartas que pienso enviarte periódicamente desde la cárcel.
Escribiéndote a ti, cuya niñez y adolescencia irremediablemente me he perdido ya, siento que les hablo a miles de jóvenes puertorriqueños, para quienes mi nombre apenas significa nada.
Soy un luchador de 70 años. Hace 32 que estoy encarcelado. No voy a abundar en las razones políticas que me condujeron a este encierro, porque otros ya lo han hecho. Sólo quiero reiterar que respeto la vida por encima de todas las cosas, y que no he lastimado ni lastimaré jamás a ningún ser humano.
La primera vez que te vi, en el verano del 91, en la cárcel de Marion, Illinois, donde estaba recluido entonces, fue a través de un cristal. Tú estabas en brazos de tu madre, y movías los ojos con curiosidad. Sin embargo, poco había que ver allí. El cubículo donde se sentaban las visitas era muy estrecho, y había un teléfono a cada lado para que habláramos por él. Clarisa, tu madre, levantó el suyo y me pidió que te dijera algo. Fue la primera vez que escuchaste mi voz y pude ver tu reacción, la extrañeza que te causó comunicarte con ese hombre que empezaba a quererte, pero que no podía besarte, ni susurrarte al oído las promesas de abuelo que te quería cumplir.
A Clarisa le dejaban pasar en el bulto tres pañales y algunas botellas de leche. Había en el área de visitas, tanto del lado de los familiares como del lado de los confinados, cámaras con las que grababan todos nuestros movimientos, pero, irónicamente, nunca me pude tomar una fotografía con mi hija y mi nieta. Siempre me escoltaban tres o cuatro guardias, y estaba encadenado por los pies. Era el único preso que iba tan custodiado al área de visitas.
Se hacía difícil entretenerte mientras estabas en el cubículo de las visitas, así que para distraerte y ayudar a tu madre, que intentaba pasar el mayor tiempo posible conmigo, inventamos un juego peculiar: ponías tus pequeñas manos de bebé en el cristal, y yo también ponía las mías, de modo que coincidieran las cuatro y pudieran «tocarse». Las manos saltaban, se perseguían, se comportaban como arañas envueltas en los hilos invisibles del cariño. No nos tocábamos, el cristal lo impedía, pero surgió un lenguaje especial entre tú y yo; entre las tiernas manos tuyas, Karina, y mis viejas manos, pálidas de encierro, deseosas de poder volar, pero contentas y sumisas cuando tú las acariciabas.
Durante años utilizamos esa danza de las manos para comunicarnos. El tiempo pasaba y tú crecías. No me estaba permitido el contacto físico con mis familiares, por lo tanto en los años que estuve recluido en Marion, no pude besarte, abrazarte, o sentir el roce y el olor de tu pelo. Tampoco el de tu madre, que me despedía con lágrimas, aunque yo sabía contener las mías.
Un día, por fin, me trasladaron a la prisión de Terre Haute, en Indiana. Allí me comunicaron que podría recibir visitas y tener contacto físico con mis seres queridos. Llegó tu madre contigo y con mi sobrina Wanda. Tú, Karina, tenías sólo siete años. Mi hija y mi sobrina me abrazaron. Tú, en cambio, te paraste frente a mí, levantaste tus manos y las pegaste contra un cristal imaginario, esperando que yo hiciera lo mismo. A tu corta edad, después de tantos años de soportar esa barrera, pensaste que debíamos continuar el juego. Tu madre te dijo: «Ahora puedes tocar a tu abuelo», y tú corriste a abrazarme, nos tocamos por primera vez.
Ese cristal, a pesar de todo, sigue siendo el cómplice entre tú y yo. A través de él, en estas páginas, te seguiré contando mis recuerdos, mis historias presentes, añorada nieta.
Con muchísimo amor, en resistencia y lucha…
Carta II: “Donde respira el mar”
Querida Karina. Después de la familia, lo que más echo de menos es el mar.
Ya han pasado 35 años desde la última vez que lo vi. Pero lo he pintado muchas veces, tanto la parte del Atlántico como la del Caribe, esa espuma sonriente en Cabo Rojo, que es de la luz mezclada con la sal.
Para cualquier puertorriqueño, vivir lejos del mar es algo casi incomprensible. Es distinto cuando uno sabe que está en libertad de moverse a cualquier parte y de viajar a verlo. No importa que sea gris y frío. Aunque veas el mar en un país lejano, te das cuenta de que recomienza siempre (como dijo un poeta), y que por ese mar pueden pasar los peces que se acercaron a tu tierra, y que llegan de allá trayéndote recuerdos.
Aprendí a nadar a muy temprana edad, debía tener unos tres años. Un primo de mi padre, que vivía con nosotros y era para mí como un hermano mayor, me llevaba a la playa donde solía nadar con sus amigos, y me lanzaba al agua para que yo aprendiera. Luego, cuando estaba en la escuela, solía escaparme con otros niños hasta un río cercano. Todo eso ahora me parece lejano.
Aquí en la cárcel he sentido muchas veces la nostalgia del mar; de olerlo a todo pulmón; de tocarlo y mojarme los labios, pero enseguida me doy cuenta de que quizá tengan que pasar años antes de darme ese sencillo gusto.
El mar se extraña siempre, pero creo que nunca lo necesité tanto como cuando me trasladaron desde la prisión de Marion, en Illinois, a la de Florence, en Colorado. En Marion, yo salía al patio una vez a la semana, y desde allí veía los árboles, los pájaros… Oía el ruido del tren y el cantío de las chicharras. Corría por la tierra y la olía. Podía agarrar la yerba y dejar que las mariposas me rodearan. Pero en Florence todo eso terminó.
¿Sabes que la ADX, que es la prisión de máxima seguridad de Florence, está destinada a los peores criminales de Estados Unidos y se considera la más inexpugnable y dura del país? Allí los presos no tienen contacto entre sí, es un laberinto de acero y cemento construido para aislar e incapacitar. Yo estuve entre los hombres que estrenaron esa cárcel.
Al llegar, me despertaban varias veces por la noche y en mucho tiempo no logré dormir por un período mayor de 50 minutos. En aquella galera éramos sólo cuatro presos, pero uno de ellos tenía un largo historial de problemas mentales y se pasaba la noche y el día gritando obscenidades, peleando su guerra contra enemigos invisibles. Estábamos casi todo el tiempo en las celdas, y hasta teníamos que comer en ellas. Todo el mobiliario era de hormigón y nada se podía mover. No comprendía cómo los vecinos del pueblo de Florence habían aceptado una cárcel tan inhumana entre ellos. Pero, hoy por hoy, la industria de las prisiones es de las más fuertes en Estados Unidos. Deja dinero y eso parece ser lo único que importa.
En Florence, por las noches, los presos se comunicaban a través de una especie de respiradero que estaba cerca del techo. Había que gritar para hacerse oír, todos gritaban y aquello lo que hacía era alterar los nervios.
Yo callaba y trataba de concentrarme en el ruido de las olas, cerraba los ojos y las veía romper contra la Cueva del Indio. El griterío de la cárcel se iba desvaneciendo. El mar subía y bajaba como un torso, contagiándome su fuerza y su respiración.
Sé que algún día pasaré toda una noche en la costa, y esperaré a que despunte el día. Luego quisiera hacer lo mismo en Jayuya, ver la salida del sol sobre la cordillera.
Con esa esperanza, en resistencia y lucha, te abraza tu abuelo…
Carta III: “La razón detrás de toda lucha”
Querida Karina. Hace pocas semanas te escribí para felicitarte con motivo del día más grandioso y memorable de tu vida: a tus 22 años, te graduabas de la Universidad de Chicago.
Te dije entonces que la vida está llena de retos y, en algunos momentos, de decepciones. Que nunca permitas que nada ni nadie te desaliente, porque tienes la fortaleza para enfrentar y superar cualquier obstáculo.
Cuando entraste a la universidad, seguramente te tocó vivir en un ambiente muy diferente del que me tocó a mí. Me alegro de eso: la razón por la que las personas luchan, en lo colectivo y en lo personal, es que las cosas cambien para que sus hijos y nietos vivan un mejor futuro.
Yo tenía tres años cuando me acerqué a la escuela, pues caminaba detrás de mis hermanos mayores, que protestaban porque los seguía. Tanto los molesté, que mi hermana decidió enseñarme a leer y escribir. Como era zurdo, ella me ataba la mano izquierda y me obligaba a usar la derecha. A los cinco años, cuando empecé el primer grado en la escuela del barrio Aibonito-Guerrero, del pueblo de San Sebastián, estaba muy adelantado gracias a esas lecciones. Me aburría en la clase y me dedicaba a hacer travesuras, invitaba a los otros niños para que nos escapáramos al río, y allí nos poníamos a tumbar naranjas.
Cuando terminé el sexto grado, aunque travieso, gané el primer premio de honor de mi clase. De allí me fui a la escuela intermedia de Hoya Mala, pero al poco tiempo de empezar las clases me enfermé. Me llevaron al médico en Aguadilla, quien me diagnosticó que había cogido un parásito en el río. Era la “justa” recompensa por mis travesuras. Me dieron desparasitantes, pero no mejoré. Cuando entré al noveno grado estaba tan raquítico que mi madre, desesperada, decidió mandarme con mis tíos a Chicago. Fui aceptado en una escuela secundaria, y al llegar tuve que pasar por un examen físico: mi estatura era de 53 pulgadas y mi peso de 58 libras. Todos los demás alumnos de esa escuela, la Tuley High School, parecían gigantes comparados conmigo. Mi vocabulario en inglés era de menos de 100 palabras. Cada vez que abría la boca, los demás muchachos se reían, y entonces me convertí en una persona introvertida. En Tuley, para la década del 50, sólo había un puñado de estudiantes puertorriqueños. Había que bregar con el discrimen, y eso te lo puedo asegurar ahora, que miro hacia atrás y veo las injusticias que se cometían. No éramos muchachos acomodados que íbamos a estudiar a los mejores colegios. Éramos los emigrantes, teníamos fama de problemáticos y, a veces, nos daban castigos que no nos merecíamos. A mí, por ejemplo, me acusaron de copiarme en un examen de álgebra. Me gustaba tanto el álgebra y estaba tan seguro de que lo dominaba, que le contesté de mala forma a la maestra y ésta me expulsó del salón y me envió a la oficina del director. Allí le dije al míster que no me había copiado y que, para demostrarlo, podía darme otro examen en ese mismo instante, frente a él, con preguntas del último capítulo del libro, que aún no habíamos dado en clase. Él me había matriculado cuando llegué a Tuley y conocía mis buenas notas, así que sonrió y me dijo que no me preocupara.
Dentro de aquel mundo duro para un muchacho puertorriqueño que apenas podía expresarse, conocí a un puñado de personas maravillosas.
Por ejemplo, tuve una maestra inolvidable en el Colegio Wright, un junior college al que asistí cuando terminé la secundaria. Éramos pobres y te confieso que me avergonzaba de mi ropa, tan ajada y fea y de mis tenis viejos, los únicos zapatos que tenía. Pero a esa maestra, que daba clases de dicción, no le importaba mi apariencia. Me dedicó mucho tiempo, con paciencia y cariño. Descubrió que yo tartamudeaba cuando hablaba inglés y me explicó cómo solucionarlo, me mandó a hacer ejercicios y lecturas. Por esa época empecé a pasar los ratos libres en un área de Chicago donde jangueaban los beats, un grupo de escritores y artistas con un gran sentido de la libertad.
Me di de baja de la Wright College cuando mi padre nos abandonó y tuve que empezar a trabajar para ayudar a mi madre. No fue hasta 1967, cuando volví de Vietnam, que regresé a la universidad. La escena había cambiado de manera drástica. Había muchos profesores progresistas, debates sobre derechos humanos en los salones y un activismo político que influyó mi vida.
Ahora veo tu éxito universitario como una prolongación de mis aspiraciones. Según sigas adelante en la vida, llena tu corazón con amor, compasión, esperanza y valor. Ámate a ti misma, a tu familia, a tus compañeros y compañeras, a la tierra, al mar, a la libertad y a la justicia, y a todo aquello que represente y haga posible la vida.
Un beso y un abrazo con brazos puertorriqueños pequeños, pero con mucho amor. En resistencia y lucha…
Carta IV: “Una callada sombra”
Querida Karina,
En estos días, he estado recordando un episodio que creo que marcó mi vida. Es curioso que la memoria guarde, de entre tantos horrores que hemos visto, un hecho en particular, que a lo mejor no es el más sangriento, ni el que más dolor causó, pero sí el que se queda para siempre en el alma, y se revive cuando somos mayores.
Tenía tu edad cuando fui llamado a pelear en Vietnam. Llegué a la guerra en marzo de 1966.
Me asignaron a la base de Lai Khe, aunque sólo estuve allí unos pocos días. Pronto me mandaron a participar en operaciones itinerantes, que duraban semanas, casi siempre bastante cerca de Saigón.
Fue en los alrededores de esa base, la de Lai Khe, donde vi por vez primera el efecto que causaba el “agente naranja”, ese defoliante usado para arrasar la selva. En la base se guardaban los barriles (con franjas de color naranja), y los aviones de asperjar el químico, que parecían inofensivos, como los de fumigar el campo. El efecto era terrible. Las plantas se secaban y morían en menos de tres días. Todo quedaba arrasado, ennegrecido, un amasijo en que era difícil distinguir cuáles huesos eran de personas y cuáles eran de animales.
Un día, ordenaron a nuestro pelotón que rodeara una aldea. Se estableció el cerco, un perímetro con puestos de control para que nadie entrara o saliera. Estuvimos seis semanas en aquel lugar, vigilando a los campesinos, que se dedicaban a cultivar arroz. Trabajaban con el agua a media pierna, siempre bajo nuestras miradas. Uno de ellos, que era de mi edad, se me acercó una tarde, luego del trabajo, puso su brazo junto al mío y dijo: “same thing”. Yo miré y me impresionó descubrir que, en efecto, teníamos los mismos brazos, fibrosos del trabajo duro.
Varias noches después, un guardia reportó haber visto movimientos y sombras sospechosas alrededor de nuestro campamento. Nos llamaron a todos y corrimos con las armas listas, apuntando hacia el lugar que el guardia señalaba. Nos dieron la orden de disparar y una lluvia de balas barrenó el follaje. Cuando nos mandaron detener el fuego, nos quedamos paralizados, sin atrevernos casi a respirar. Aquella sombra sospechosa volvió a moverse en la maleza. El jefe del pelotón ordenó que apuntáramos de nuevo, y allí cayó otra lluvia de disparos. No se volvieron a ver sombras, mas nos quedamos intranquilos durante toda la madrugada.
Tan pronto comenzó a clarear, oímos gritos desgarrados que provenían de los campos de arroz y fuimos corriendo al lugar. Tres o cuatro campesinos lloraban frente al cadáver de un búfalo de aguas, el único que había en toda la aldea para labrar la tierra. Ese animal había sido la callada sombra que matamos.
El más joven de los hombres que lloraban era el muchacho que había puesto su brazo junto al mío. Tenía la ropa y la piel manchadas de la sangre del búfalo. Me miraba fijo.
Luego, parte del pelotón fue trasladado a un área que estaba sembrada de minas y de aquellas trampas llamadas “booby traps”, con las que muchos resultaron heridos. De 31 hombres que éramos en el grupo, 17 quedaron fuera de combate. Trabajamos mucho localizando aquellas trampas, despejando el terreno para que los helicópteros bajaran, y abriendo paso para que las camillas pudieran llevarse a los heridos.
El muchacho que lloró a su búfalo debe tener mi edad, si es que aún vive. No podrá imaginarse que he estado preso por 32 años y que, en ese tiempo, he pensado a menudo que él tenía razón: su brazo y el mío eran la misma cosa.
En resistencia y lucha, te abrazo tu abuelo,
Oscar López Rivera
Carta V: “La historia de Jíbara Soy”
Querida Karina:
Querida Karina, he oído hace poco la noticia de un perro labrador que murió a balazos en una casa de Santurce y no he podido evitar acordarme de los perros que me acompañaron en la vida, y que estuvieron a mi lado, en las buenas y en las malas, hasta el mismo día en que me arrestaron, cuando me despidieron con sus miradas sabias.
Siempre tuve perros a mi lado. De niño, en San Sebastián, y luego en mi juventud, cuando emigré a los Estados Unidos. Y hasta en Vietnam, donde también ellos sufrieron los horrores de la guerra. Eso se echa de menos en la cárcel: la cercanía de un animal tan noble, que es capaz de entenderte, de compartir nostalgias y asimilar tristezas que brotan de nosotros.
En 1973, cuando vivía en Chicago, tuve una perra singular: una doberman pincher que se llamaba Jíbara Soy. Era la mascota más popular del barrio. Protectora e inteligente, queriendo siempre llamar la atención. Para entonces, yo había rentado un pequeño apartamento en la misma propiedad donde mi hermano mayor tenía su casa. Una de las condiciones para el alquiler era que no podía tener la perra, pero ocurrió que una noche entraron unos ladrones a la casa y convencí a mi hermano para que la aceptara.
Pocas semanas después me ausenté por unas horas y al llegar encontré que Jíbara Soy había convertido el hermoso jardín que mi hermano cuidaba con esmero en una especie de campo de batalla. Había hecho enormes agujeros de los que sacó ratas del tamaño de un gato. La bañé, la llevé al veterinario para asegurarme de que no tenía heridas y no corría peligro de contraer alguna enfermedad.
De vuelta a casa, hice lo que pude en el jardín, tratando de arreglar los destrozos. Cuando regresó mi hermano del trabajo, le dije que le tenía dos noticias, una buena y otra mala. La buena era que Jíbara Soy había matado nueve ratas. La mala la pudo ver con sus propios ojos: el jardín estaba estropeado y habría que trabajar el doble para devolverle su lozanía.
Mi hermano y su esposa se encariñaron con la perra, que nos acompañó varios años. Tenía su propia butaca, escuchaba con atención la música clásica y, siempre que yo me ponía a leer en la sala, mantenía sus ojos clavados en mí, como si me leyera el pensamiento y se enterara del significado de la lectura.
Un día se puso de parto y murió. Hasta entonces, creía simplemente que estaba muy gorda, pues el veterinario le daba pastillas anticonceptivas. Algo falló y murió dando a luz a 16 cachorros.
Tu mamá, Clarisa, es gran amante de los animales. Tú también te desvives por ellos. Entonces comprenderán cuando les diga lo difícil que fue dejar atrás a mis dos perros el día que me arrestaron. Yo vivía en la clandestinidad y ellos me hacían compañía, sobre todo cuando la situación era desesperante. Un día, descubrieron mi paradero y me arrestaron. De mis sentimientos en ese instante, y de mis temores cuando me alejaba, te hablaré en otra ocasión. Solo quiero contarte que aquel día de mayo de 1981, estando bajo arresto, se me acercó un agente del FBI que se identificó como puertorriqueño. Lo primero que le pregunté fue que qué habían hecho con mis perros. Me respondió que los habían llevado a ASPCA, que era el “animal shelter”. Algo en su expresión me hizo pensar que no era cierto. Le insistí para que me dijera la verdad. Hubo un silencio largo que yo sabía lo que significaba. Pensé en la fidelidad de esos dos perros, y la memoria me trajo, uno tras otro, el recuerdo de todos los que había tenido, desde que me criaba en San Sebastián. Pensé en los animales malheridos que había visto en Vietnam. Y al final, me pareció escuchar los ladridos valientes de mi Jíbara Soy. Entonces oí lo que ya sospechaba: “Los tuvimos que matar”.
Treinta y dos años han pasado desde entonces.
Amo a los animales que perdí. A los que fueron míos y no pudieron morirse con mis palabras de consuelo y mi mano rascándoles el lomo. Y amo a los que tendré en Puerto Rico algún día.
En resistencia y lucha, tu abuelo,
Oscar López Rivera
Carta VI: “Para ser lo que somos”
Querida Karina,
Estoy seguro de que a veces te preguntarás por qué tu abuelo escogió un camino diferente. Por qué nunca te recogió en la escuela, ni está en las fotos de tu cumpleaños, ni en las de Navidad, sentado frente al arbolito.
Ahora, viendo hacia atrás en la memoria, creo que te puedo responder que es el camino el que nos escoge a nosotros; la lucha te atrapa si tienes abierto el corazón y la voluntad para combatir las injusticias.
A fines de los años sesenta, había muchas denuncias de discrimen contra los hispanos en una empresa de teléfonos de Chicago que se llamaba Illinois Bell. Un grupo de latinos nos organizamos para protestar en el downtown, donde estaba la oficina principal de esa empresa.
El presidente de la Illinois Bell era entonces Mr. Charles Brown, pero a nosotros sólo nos permitían hablar con uno de sus asistentes, también latino, un peruano que no tenía autoridad para ayudarnos.
Un día nos dijeron que Mr. Brown solía acudir a una iglesia presbiteriana en Lake Forrest, el suburbio más exclusivo de Illinois.
Allí nos presentamos un domingo, celebramos un acto ecuménico frente a la iglesia y luego entramos. Los feligreses se asustaron al ver esa invasión de latinos que avanzaba por los pasillos repartiendo hojas sueltas. Sólo hubo un problema: Mr. Brown no había asistido aquel domingo al servicio religioso. Sin embargo, nos paramos frente al púlpito y le explicamos al público que todo lo que queríamos era hablar con Mr. Brown y presentarle nuestras demandas laborales, pues en su empresa atropellaban a los hispanos. Dicho esto, les dimos las gracias y nos retiramos.
Poco después, cuando regresamos a nuestro local, recibimos la llamada de una de las personas que estaban en la iglesia: quería darnos la dirección de Mr. Brown.
Algunos compañeros volvieron a Lake Forrest para identificar el lugar. Varias semanas más tarde, alquilamos autobuses y nos metimos en ellos con nuestras familias para protestar de nuevo, esta vez frente a su propia casa. A los niños les habíamos dicho que íbamos de picnic y cada cual llevaba una «luncherita» con golosinas.
En aquellos años no había control de acceso en las urbanizaciones de lujo, y ni siquiera portones en la propiedad. Nos sentamos alrededor de la piscina y fue imposible evitar que los niños se tiraran al agua. Enseguida vimos que desde la mansión se abría una puerta y Mr. Brown en persona nos invitaba a pasar.
Diez de nosotros nos acercamos para hablar con él, y la reunión fue en la cocina. En un momento dado se excusó para llamar a su hijo, que sabía español y quería que sirviera de intérprete. Le dijimos que no hacía falta, porque todos éramos bilingües.
Entonces nos citó para la mañana siguiente en la empresa y allí nos volvimos a reunir. Estuvo de acuerdo en contratar de inmediato a 125 trabajadores latinos para distintos departamentos de la Illinois Bell, y en abrir dos oficinas en sendas comunidades hispanas, una para mexicanos y otra para puertorriqueños, a fin de darles servicios en español.
También aceptó contratar a un determinado número de obreros latinos cada año.
Aquel acuerdo con Mr. Brown fue una gran victoria para nosotros, que, casi sin proponérnoslo, habíamos fundado la Coalición Hispana del Trabajo. De ahí en adelante, reivindicamos el derecho de los obreros en otras empresas, sobre todo en la construcción.
Demandábamos que emplearan a trabajadores hispanos, y fuimos muy exitosos logrando que accedieran a nuestros reclamos. No hubo violencia en todo aquello, solamente trabajo y más trabajo, y una gran movilización étnica, planificada al mínimo detalle.
A los latinos, por fin, se nos empezaron a abrir las puertas de las empresas y las uniones obreras que habían estado cerradas para nosotros.
Más tarde, todo ese esfuerzo se concentró en las escuelas y universidades. Pienso que, para ser lo que somos, tenemos que hacer sacrificios de todo tipo. Quizá nunca te ayudé a soplar las velitas de tu cumpleaños, como hacen tantos abuelos con sus nietos, pero me consuela pensar que he puesto mi granito de arena para construir un mundo más iluminado y justo para ti.
En resistencia y lucha, te besa
Oscar López Rivera
Carta VII: “Todos escucharon”
Querida Karina,
Cuando hace poco te conté de las luchas de los hispanos contra el discrimen laboral, me acordé de mi primer intento por organizar una protesta. Muchos inmigrantes puertorriqueños vivían en condiciones infrahumanas, en edificios llenos de alimañas, con escaleras inseguras y techos que se caían a pedazos. Los dueños de aquellos edificios nunca se ocupaban de darles mantenimiento, pero sí se ocupaban de mandar a cobrar la renta cada mes, y hacerle la vida imposible a todo aquel que se atrasaba.
Empecé a visitar a las personas que vivían en las peores condiciones, tocando a cada puerta para organizarlos. La primera mujer con la que hablé me dijo: «¿Quién va a escuchar a una puertorriqueña?». La respuesta me salió del alma: yo la escucharía a ella, y luego los dos iríamos a escuchar al resto, y al final todos escucharíamos a todos. La convencí y empezamos a hablar con los demás inquilinos. Nuestro único propósito era que limpiaran el edificio, arreglaran las tuberías y pasamanos dañados, y eliminaran la multitud de ratas y cucarachas con las que tenían que convivir tantas familias.
Al propietario de uno de los edificios lo confrontamos y le advertimos que los vecinos no pagaríamos la renta hasta que adecentara el lugar. Él nos ignoró, pero cuando vio que llegaba la hora de pagar y nadie lo hacía, accedió a limpiar y hacer algunas reparaciones. No podía imaginarme entonces que corríamos un gran riesgo: la mayoría de los dueños de esos edificios levantaban fortunas a costa de atropellar a las personas que se veían forzadas a vivir en la inmundicia. Si tenían que invertir dinero en muchas reparaciones, preferían prender fuego a la estructura para cobrar el seguro.
Había un político en Chicago que poseía varios edificios. Todos estaban en malas condiciones, pero allí tenían que vivir muchos puertorriqueños sin que nadie oyera sus reclamos. Hasta que un día, entre varios vecinos, atraparon algunos ratones y los metieron en una caja. Aquella caja se envolvió en papel de regalo y fue llevada por nuestras mujeres a la mansión del político, donde la recibieron porque ellas dijeron que era un obsequio en agradecimiento a sus buenas acciones. La esposa del político fue la que abrió la caja y se formó un gran escándalo. Entonces mandaron a asear los edificios.
A la misma vez, luchábamos para que los bancos dejaran de discriminar contra los inmigrantes. La mayoría de nosotros tenía cuentas de ahorro y mantenía buen crédito, pero el banco nunca nos prestaba para la hipoteca o para comprar un carro. Se nos ocurrió una idea: les dimos a los niños de la comunidad unos potes grandes llenos de chavitos. Los llevamos un sábado por la mañana al banco, que era el día en que se abarrotaba de clientes, para que cada niño abriera una cuenta y exigiera al cajero que contara chavito a chavito. La fila se hizo interminable, con todos los chamaquitos haciendo ruido y gritando a la vez. Entonces alguien sugirió que los chavitos también servían para trabar las puertas giratorias… Eso hicimos. Nadie podía entrar ni salir del banco. Pronto llegó la policía y se topó con un piquete de latinos que exigía que se les diera un trato digno. El escándalo se llevó a cabo en una sucursal que quedaba en la esquina de la calle Division con la avenida Ashland. Uno de los altos ejecutivos del banco se allegó hasta el lugar y accedió a hablar con nosotros. Se comprometió a atender nuestras demandas y a contratar personal latino para las sucursales.
Las puertas del banco se destrabaron y los niños celebraron tirando los chavitos al aire. Una mujer puertorriqueña, abuela de dos, fue la que encabezó la protesta contra el banco. Sus ojos brillaban más que el reflejo de las monedas al vuelo. Todos nos habíamos escuchado unos a otros, y así nació una fuerte solidaridad.
En resistencia y lucha, tu abuelo
Oscar López Rivera
Carta VIII: “De frente a la cara del miedo”
Querida Karina,
Cada cual decide su destino y arriesga el alma según lo dicta su conciencia. El miedo siempre está presente. En cada momento. Día y noche. Pero uno aprende a usar el miedo en beneficio propio. En Vietnam, por ejemplo, fue el miedo lo que me ayudó a ser cauteloso, atento a todo cuanto me rodeaba, a los movimientos y los sonidos inusuales. Hubo meses, años enteros en los que sobreviví gracias al instinto, olfateando el aire para poder detectar el peligro.
Cuando llegaba algún soldado nuevo al batallón y lo veía presumiendo de su fuerza o de su valentía, me mantenía observándolo. Me daba cuenta de que ésa era su forma de impresionar a los demás, escondiendo el pánico que sentía. Luego, cuando le tocaba entrar en combate, ocurría una de dos: o se quedaba paralizado, o se comportaba de forma temeraria. En cualquier caso, me lo llevaba aparte y le explicaba que todos sentíamos miedo y era normal. Que lo importante era reconocerlo, porque al no tomar precauciones o quedarse «freezado» en pleno fuego, ponía en peligro su vida y la de los demás.
Creo que haberme criado en las calles de Chicago fue un buen entrenamiento para manejar el miedo.
Años más tarde, cuando me destinaron a la prisión de Marion y enfrenté por primera vez lo que llaman «régimen de privación sensorial», no tenía idea ni de lo que iba a encontrarme, ni de la gente con la que iba convivir. Me ubicaron en la «gang unit», con pandilleros peligrosos de todo el país. Nadie con honestidad puede decir que no teme por su vida en un lugar así. Casualmente, reconocí a un par de reclusos que habían estado conmigo en la cárcel de Leavenworth y se mostraron solidarios. Sabían que yo no procedía del mundo de las pandillas y que era un preso politico.
Tan pronto supe que tendría tan sólo quince minutos mensuales para hablar por teléfono, que en la práctica eran menos, pues las llamadas las cortaban o se interrumpían, me oprimió la pena. Mi madre era mayor y estaba enferma; era ella quien me mantenía al tanto de mis hermanos y el resto de la familia en Puerto Rico. Lo más doloroso era no poder hablar con mi hija, que entonces era una niña. Como ella casi no me conocía, era poco lo que me contaba por teléfono. Cuando recibía visitas, me prohibían el contacto físico con mis familiares. Aún recuerdo la primera vez que me visitó mamá, tu bisabuela, que rompió a llorar al verme esposado al otro lado del cristal. En aquella ocasión le dije que tenía que ser fuerte y contener el llanto para no demostrar a los carceleros que ese régimen abatía a toda la familia. De ahí en adelante, cuando me visitaba, la veía apretar la boca y contener el llanto. En mi presencia, no derramó otra lágrima. Fue una puertorriqueña valiente.
Distinto a la cárcel de Leavenworth, en Marion revisaban o interceptaban toda mi correspondencia y el material de lectura que recibía. A veces, pasaban semanas o meses hasta que me entregaban las cartas, revistas o periódicos. Me lo daban todo el mismo día, y al siguiente entraban a la celda para registrarla y confiscar lo que ellos llamaban «un exceso de papeles», muchas cosas que yo no había tenido tiempo de leer.
Hasta que se me ocurrió la manera de conservar los periódicos, repartiéndolos, cuando me los daban, entre los demás reclusos, quienes poco a poco me los iban devolviendo. En la prensa eran noticias viejas, pero igual las leía todas.
Hay que leer siempre, Karina, la lectura también sirve para aplacar el miedo. Para alejar la soledad, de la que te hablaré algún día.
En resistencia y lucha, tu abuelo,
Oscar López Rivera
Carta IX: “Aire de libertad en el rostro”
Querida Karina,
Hace unas noches, quizá porque te escribí antes de acostarme, tuve un sueño con tu madre y contigo. Estábamos los tres frente al mar, ese que anhelo ver más que ninguno, que es el que rompe contra la Cueva del Indio.
Te preguntarás, ahora que te cuento esto, con qué sueñan las personas que han estado durante tantos años privadas de la libertad. Es posible que, aunque estemos encerrados, nos obstinemos en soñar con las calles y la luz, y con los rostros que nos están vedados.
Para mí fue así: durante los primeros tiempos mi patrón de sueño era esencialmente el mismo que antes de ser encarcelado. Pero todo cambió cuando me colocaron en régimen de «privación sensorial». Entonces los sueños se tornaron nerviosos, entrecortados, fugaces. El aislamiento y el encierro absoluto alteraron la calidad de mi descanso. A partir de aquella experiencia, casi nunca he vuelto a dormir un sueño relajado o profundo.
Si tú o tu madre Clarisa aparecen en mis sueños, usualmente es por corto tiempo. De vez en cuando hay algo de conversación y lo mismo sucede con otros miembros de la familia y con mis compañeros.
En la oscuridad de la celda, la soledad golpea doblemente. Es triste el no poder compartir mis ideas, pensamientos y tribulaciones con otros que están en la misma situación que yo. ¿Sabes lo que echo de menos? No poder dialogar acerca de un libro que acabo de leer. Parece algo insignificante, algo banal con tantas penas que trae la soledad, pero no lo es.
Hace años, yo disfrutaba mucho resolviendo problemas de matemáticas y leía cuanto libro podía conseguir sobre ese tema. De vez en cuando me encontraba a un prisionero que también lo había leído, y era motivo de regocijo para ambos, pero eso no ocurría con frecuencia. Ahora paso las horas pensando cómo se resolverán otros problemas: los de la violencia en las comunidades; la deserción escolar, la corrupción… Es difícil intercambiar ideas a través de las cartas, porque uno ansía reacciones inmediatas, el diálogo fecundo con los demás.
Toda mi vida disfruté de la lectura, del placer de leer a solas. Quizá por esa razón me resultó más fácil enfrentar los rigores del confinamiento, en especial eso que llaman solitaria. Con el tiempo me di cuenta de que la única manera de sobrevivir es mantenerse ocupado. Por supuesto que hubo y hay momentos de melancolía, que es la soledad que muerde. Pero rápido alejo esos nubarrones de mi mente y pienso en otra cosa. El simple hecho de que me dejen hacer una llamada breve, o mandar un correo electrónico, o recibir una visita, hacen de la prisión actual algo más llevadero que en aquellos años de aislamiento.
En cuanto a esa pregunta que me hiciste sobre mi futuro, te diré que en las noches, en esos baches de insomnio, miro al techo de la celda y medito en las cosas que quisiera hacer. El futuro para mí es algo impredecible, pero el miedo no es parte de un futuro fuera de este gulag. Ni siquiera me planteo si voy a sentirme cohibido, o si la realidad me será extraña, o si me encogeré frente a un mundo que me costará reconocer. Puerto Rico ha cambiado. El Chicago de mi adolescencia también. Esas noches en que me desvelo pensando en mis proyectos, me animo diciéndome que, al fin y al cabo, he sobrevivido 70 años y he caminado bajo la sombra de la muerte en muchas ocasiones.
Si un hombre ha podido sobrevivir a eso, ¿cómo le va a temer al aire de la libertad cuando le dé en el rostro?
En resistencia y lucha, tu agradecido abuelo,
Oscar López Rivera
Carta X: “La danza del recuerdo”
Querida Karina, Hace poco recordaba que el gran músico Andy Montañez tiene un cuadro que pinté hace tiempo y en el que están los dos, tú junto a él. A ambos los admiro por razones distintas. A ti, porque estudias con ahínco y te enorgulleces de pertenecer a donde perteneces.
A Andy, por motivos obvios, porque es una institución de la música de mi País y porque siempre ha sido fiel a sus principios, un artista que pone la valentía por delante.
¿Sabes por qué nunca he querido que la gente se refiera a mi “liberación”? Porque soy libre, Karina. Y la música ha contribuido mucho a esa libertad. Prefiero que se diga la “excarcelación” de Oscar. La libertad no la he perdido nunca.
Mis gustos por la música han sido siempre eclécticos, me gustan muchos géneros. Pero la música puertorriqueña me conmueve más que cualquier otra.
Empecé a bailar salsa hace muchos años, antes que se llamara salsa. La primera vez que Cortijo y su Combo fueron a Chicago, un primo mío me pidió que fuéramos a verlos. Y, por supuesto, fuimos, pero para ese entonces yo no sabía bailar. Sin embargo, como buen boricua, me atreví a sacar a una muchacha, que al fin y al cabo quedó decepcionada con mi poca aptitud. Luego de aquel bochorno, poco a poco me dediqué a aprender yo solo. Para la época en que decidí que iría a otro baile, la verdad que no era precisamente el bailarín con que sueña una mujer.
Más tarde empecé a frecuentar diferentes áreas de la ciudad donde los jóvenes puertorriqueños celebraban fiestas que en Puerto Rico llamarían “de marquesina”, pero para nosotros eran “de apartamento”.
A medida que se abrían algunos locales con música latina, me acercaba a ellos y creo que bailaba cada vez mejor. Cierta noche, conocí a una puertorriqueña a la que le encantaba bailar. La primera vez, mientras bailábamos, me preguntó si le podía dar pon hasta su casa. Le dije que lo haría encantado, aunque, tan pronto entramos al carro me advirtió que no esperara nada que no fuera una buena amistad.
Las cosas quedaban claras y ella agregó que esa amistad sería beneficiosa para mí. De hecho, lo fue. Era como cuatro pulgadas más alta que yo y siete años mayor. Me empezó a llevar a lugares donde todo el mundo la conocía como una excelente bailarina. Un domingo por la tarde, en uno de esos clubes, un puertorriqueño de mediana edad se nos quedó mirando y de pronto comentó que ella era demasiado para mí, como mujer y como pareja de baile. Me quedé preocupado, yo era un muchacho y pensé que aquel hombre me estaba invitando a pelear, pero ella se paró en medio de todos, puso los brazos en jarra y sacó una voz dura para decirle que yo, probablemente, era más hombre y mejor bailarín que él. Ahí terminó el incidente.
Recuerdo a esa mujer cuando oigo música, y me lamento de haber decepcionado a tantas muchachas bailando regular como bailaba; y de hacer pasar tantas malas noches a los vecinos cuando organizábamos bailes durante los fines de semana y nos amanecíamos haciendo ruido.
Bailé con la música de El Gran Combo, de Tito Puente, de Tito Rodríguez, de Eddie y Charlie Palmieri, de Joe Cuba, Tommy Olivencia, Pete “El Conde” Rodríguez, Ray Barreto y orquestas de salsa menos conocidas que iban surgiendo en Chicago.
Ya no tuve tiempo para bailar cuando empecé en la labor comunitaria y me uní a la lucha política. Pero aún tarareo las canciones de mi juventud y pienso que el baile también nos da una libertad, que es la de la memoria.
En resistencia y lucha, tu abuelo,
Oscar López Rivera
Carta XI: “Oración entre cuchillas”
Querida Karina,
¿Has leído sobre el caso de George Stinney, un niño de 14 años que murió en la silla eléctrica, acusado de haber cometido un crimen que al parecer no cometió? Fue la persona más joven a la que se le aplicó la pena de muerte en Estados Unidos. Ocurrió en en el año 1944, y ahora ha surgido un movimiento interesado en reabrir el caso.
A Stinney, que era delgado y bajito, hubo que calzarlo con un libro, porque no daba la talla para la silla eléctrica, que estaba construida para matar hombres. Eso me ha hecho recordar a un muchacho que conocí durante mis primeros tiempos en la prisión de Marion. Tenía dieciocho años y había sido convicto por asaltar un banco, a punta de cuchillo, para llevarse 265 dólares. Supe, por otros prisioneros, que arrastraba problemas familiares y que cuando cometió el delito, trataba de llamar la atención de su papá, que había abandonado el hogar. El juez le dio una sentencia mínima y ordenó que lo ingresaran en una institución para jóvenes descarriados. Y así fue. Pero al parecer tuvo varios encontronazos con los guardias penales, llegó a golpear a uno de ellos y pronto fue transferido a otra instalación sin ningún tipo de programas para rehabilitarlo.
Su situación fue de mal en peor, y volvió a enfrentarse al personal de la prisión, especialmente a un capitán puertorriqueño que, sabiendo ya que el muchacho venía de haber golpeado a otro guardia, le hizo la vida imposible.
Por último, dándolo por incorregible, lo trasladaron a Marion. Fue a parar a la misma unidad en que yo estaba, y un día que lo vi deprimido, le di papel y lápiz y me di cuenta de que era capaz de dibujar muy bien. Sólo había que tenerle paciencia y dejar que se expresara.
A pesar de eso, seguía dando muestras de desequilibrio. De vez en cuando me decía que el «dios» que hablaba en su cabeza lo mandaba a hacer esto o aquello. Yo sabía que algo andaba mal, pero lo animaba para que leyera, para que siguiera dibujando y se mantuviera calmado. No le daban ningún tipo de ayuda psicológica, ni lo medicaban.
Hasta que un día vino a decirme que «dios» le había ordenado que abandonara la prisión. Le pedí que no cometiera esa locura; que era bueno que rezara y leyera la biblia, pero que tenía que enfocarse en sus aspiraciones y en su talento para dibujar.
Al día siguiente, mientras estábamos en el patio, se formó un gran alboroto y vimos que el muchacho había tratado de brincar una verja. Lo hizo tan rápido que ni nosotros, ni siquiera el guardia de la torre de vigilancia más cercana se dio cuenta. Desde otra torre avisaron que había un hombre que intentaba fugarse, y todos alzamos la vista y pudimos divisarlo arriba, entre los alambres de cuchillas, arrodillado y con las manos juntas, como si estuviera rezando. Lo recuerdo y se me parte el alma. Noté que el uniforme que llevaba puesto poco a poco tomaba otro color, rojo de sangre.
Nos mandaron a desalojar el patio y entramos todos a las celdas. Sé que a los guardias les tomó como quince minutos alcanzar el lugar donde estaba el muchacho. Una hora después oí en la radio la noticia de que acababan de frustrar una evasión en Marion.
Nunca supe cómo terminó aquel joven. Uno de los guardias me contó que, cuando al fin pudieron bajarlo, todo su cuerpo estaba cubierto de heridas. ¿Por qué lo enviaron a una prisión como aquélla, con hombres mucho mayores que él, algunos de los cuales habían cometido crímenes horribles? El juez había recomendado que lo llevaran a un lugar donde pudieran ayudarlo, y, por el contrario, terminó en aquel duro agujero, más despiadado que cualquier gulag.
Por aquella época, cuando todavía estábamos impresionados por el episodio, sabiendo que en los periódicos lo comentaban, uno de los prisioneros se me acercó y me dijo que una cosa era leer y oír sobre la prisión de Marion, y otra muy distinta experimentar la realidad que estábamos viviendo.
Tú, Karina, ante toda realidad, mantente fuerte.
En resistencia y lucha, tu abuelo,
Oscar López Rivera
Carta XII: “Una ventana perfecta”
Querida Karina,
Raramente veo la televisión, pero el jueves 21 de noviembre, por pura intuición, me senté a ver los Grammy’s latinos junto con otros prisioneros.
Cuando Ricky Martin dijo «¡Justicia y libertad para Oscar López!», me estremecí de emoción y gratitud. Ricky es un hombre valiente cuya voz es respetada. En ese mismo instante pensé en la caminata que tendría lugar el sábado 23, y en mi mente imaginé un extraordinario evento. Sin saber a ciencia cierta todo el trabajo que se estaba haciendo, presentí que muchos se unirían.
Llegado el sábado, cuando pude llamar a tu mamá, ella me dijo cuán asombroso empezaba a ser todo. La marcha aún no había salido, y esperé un rato para volverla a llamar. Los minutos se me hacían eternos. Quería reservar el poco tiempo que puedo hablar por teléfono, a fin de que la actividad estuviera en todo su apogeo cuando volviera a llamar.
Y lo logré. Cuando me volví a comunicar con Clarisa, pude oír la música y las consignas de los manifestantes. Querría explicarte la conmoción que envuelve a una persona que está encarcelada, cuando se da cuenta de que miles de hombres y mujeres, bajo el sol y el cielo y el aire de las calles, se unen para pedir que se abran los barrotes y vayas a reunirte con ellos. Es una felicidad, y a la vez una pena indescriptibles. Hace falta ese apoyo, el calor inmediato de la gente, te dan ganas de abrazarlos a todos, y te afliges porque te das cuenta de que no puedes hacerlo.
Más tarde, hablé con Jan Susler, que estaba en la caminata y a través de su celular pude saludar a varias personas que marchaban con ella. A unos los conocía de antes; a otros no, pero de cualquier forma me emocionó establecer ese contacto con tanta gente que estaba sacrificando la tarde del sábado para pedir mi excarcelación.
El entusiasmo era contagioso. Conversé con los congresistas Nydia Velázquez y Luis Gutiérrez. Ambos me llenaron de ánimo y prometieron venir a visitarme. ¿Cómo les puedo agradecer su gesto, las peticiones que han hecho en favor de mi excarcelación?
Oyendo esas voces, comprendí que la palabra es una ventana perfecta para contemplar el mundo exterior. Gracias a la palabra, a todo lo que me contaban, logré apreciar con ojos propios la maravilla del espectáculo que celebraron.
En verdad pienso que ese evento ha validado todos los demás esfuerzos llevados a cabo durante este año para tratar de sacarme de prisión. Es también un grandioso ejemplo de lo que es el alma puertorriqueña, su bondad y su nobleza.
Me enorgullece saber que miles de personas olvidaron sus diferencias políticas, cruzaron líneas ideológicas y credos religiosos, y se congregaron por encima de distancias generacionales: jóvenes con viejos. Al ver las fotos, me recordó un gigantesco «quilt», una de esas colchas confeccionadas con diferentes trozos de tela, pero que sirven para una misma cosa: abrigar al ser humano. Yo me sentí abrigado.
Pude ver a los 32 Niños x Oscar y a los alumnos de la escuela Montessori en la Playa del Escambrón. Y pude ver, también, a las 32 Mujeres, vestidas con sus coloridas ropas, pidiendo mi regreso a casa.
Adiviné las caras, incluso aquellas que no he visto nunca. Ha sido una gran lección para mí entender cuán creativo y laborioso puede ser mi pueblo cuando se lo propone.
Me divertí como un niño viendo a las mariposas Monarca creadas por las manos de artistas puertorriqueños. Fíjate, Karina, que esas mariposas viajan miles de kilometros desde Canadá y Minnesota para refugiarse en los bosques de oyamel, una especie de abeto que hay en México. Esta vez, las mariposas volaron en dirección distinta, viniendo desde Puerto Rico a mí, hasta esta cárcel y a la ventana de mi imaginación.
Toda esa marcha, desde principio a fin; todo ese pueblo que clamaba libertad y justicia, ha llenado de esperanza mi pobre y limitada vida. Demuestra también el coraje de mucha gente para pensar de forma diferente, y significa, por último, que hasta el más pequeño de los niños es capaz de participar en la búsqueda de una vida mejor, dirigida a descolonizar el País y descolonizar de paso nuestras propias mentes.
Tendré por siempre en mi memoria, hasta el día en que muera, el recuerdo del 23 de noviembre y la caminata que me dedicaron.
En resistencia y lucha, tu abuelo, su conmovido corazón,
Oscar López Rivera


